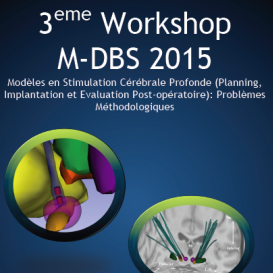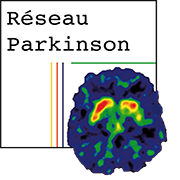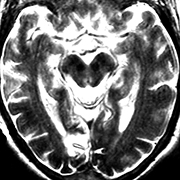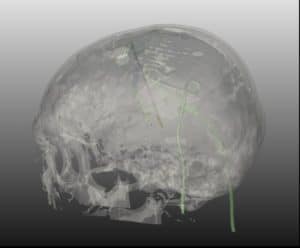Contrôle de l’action et reconnaissance des émotions faciales dans la maladie de Parkinson
Le docteur Paul Sauleau membre de l’équipe EA4712 encadre un groupe de recherche consacré au contrôle de l’action et à la reconnaissance des émotions faciales dans la maladie de Parkinson